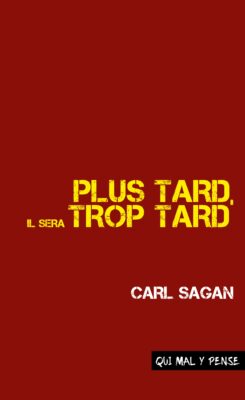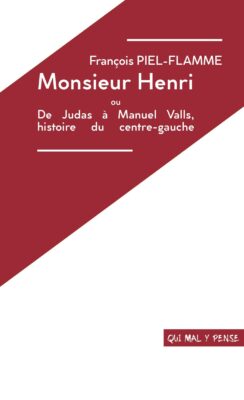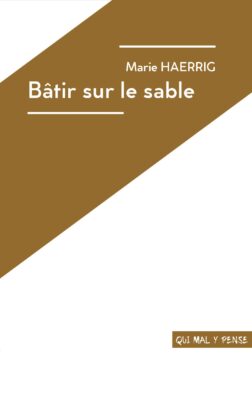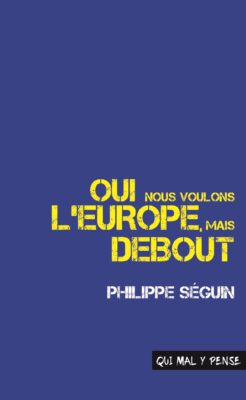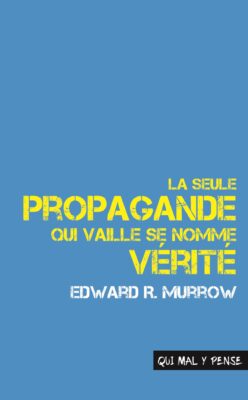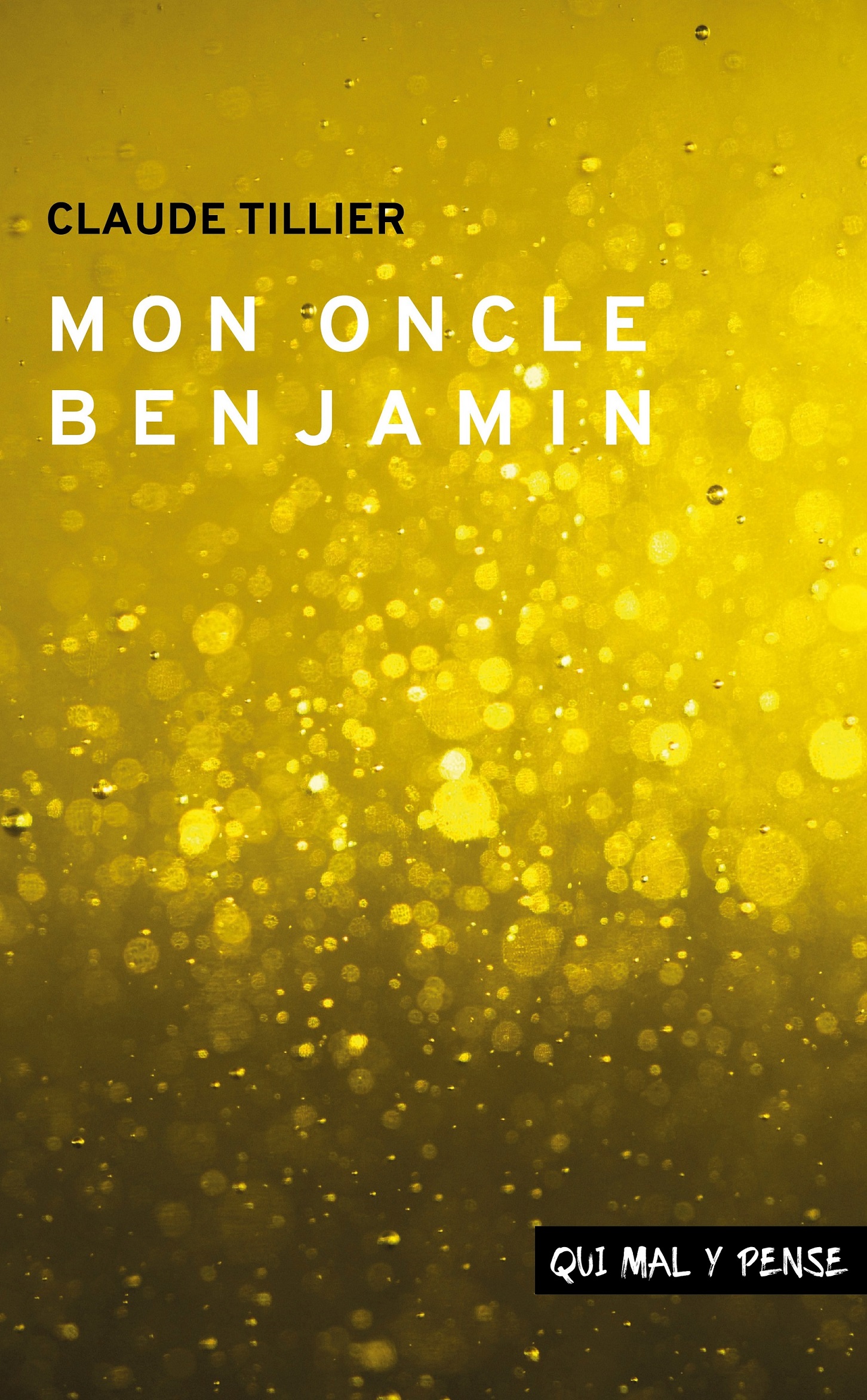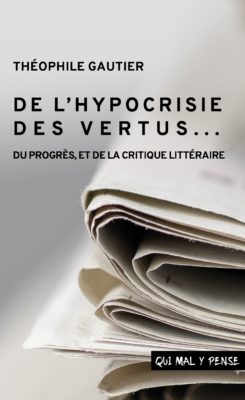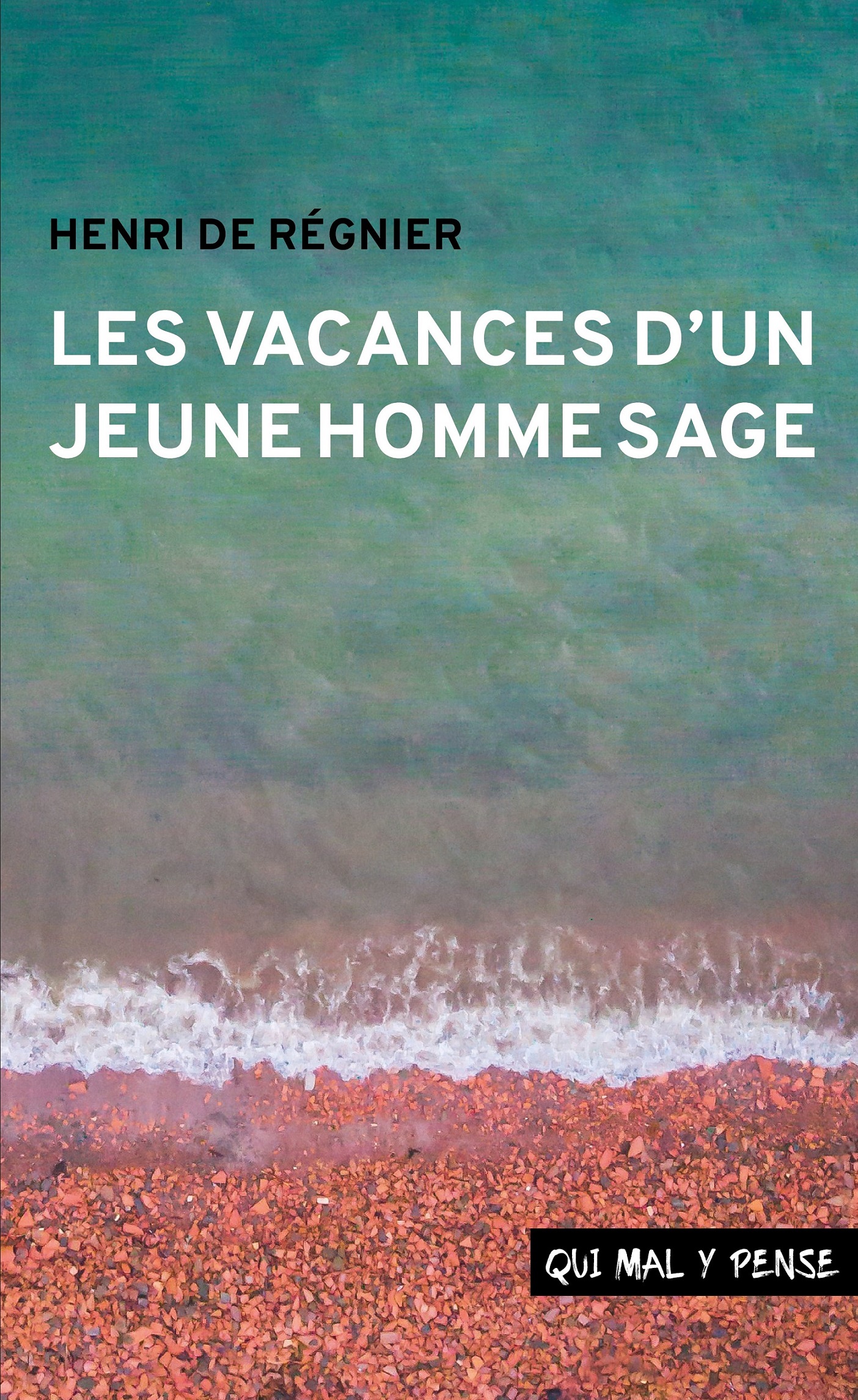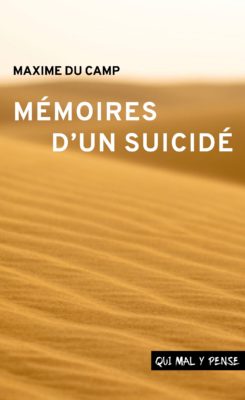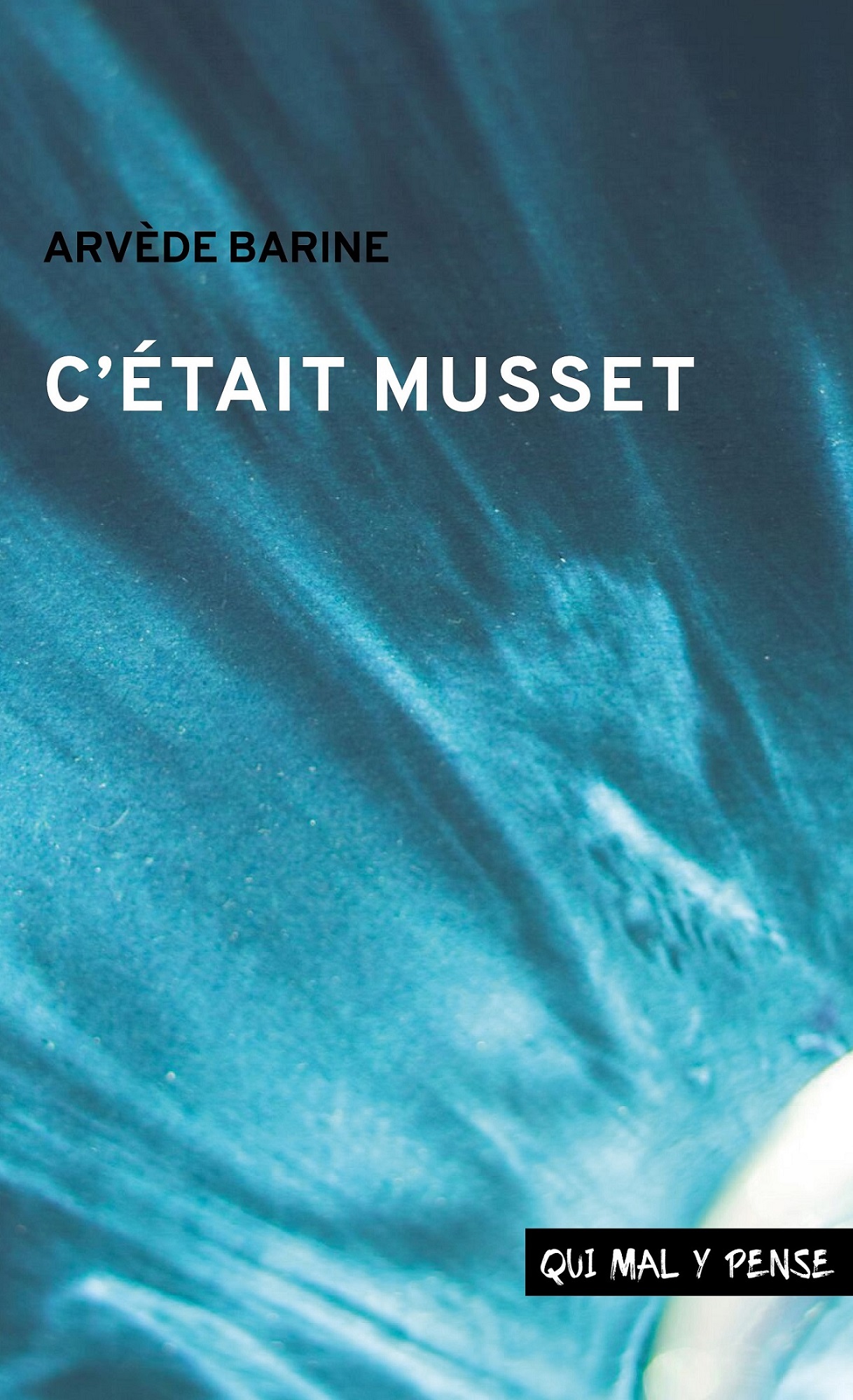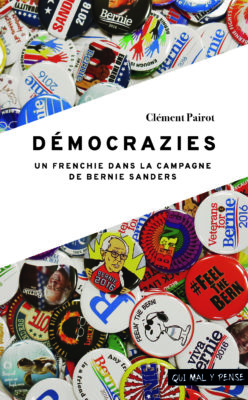La Malle Y Pense est arrivée !
Plus tard, il sera trop tard
A l’occasion de la COP28, deux générations d’astrophysiciens réaffirment l’urgence à agir contre le dérèglement climatique malgré l’inaction manifeste du politique. C’est un jour de décembre 1985 que Carl Sagan, considéré outre-Atlantique comme l’un des plus grands vulgarisateurs scientifiques du XXème siècle, fut invité à décrypter devant le Sénat américain les mécanismes anthropiques contribuant à l’effet de serre, déjà bien établis scientifiques mais alors encore méconnus du grand public. Quatre décennies plus tard, Jean-Philippe Uzan dresse un bilan franc, raisonné et implacable du temps perdu dans une course contre la montre dont l’enjeu n’est rien de moins que l’avenir de l’humanité. Si 40 ans les séparent, le constat scientifique, lui, reste immuable. Carl Sagan et Jean-Philippe Uzan balaient donc à l’unisson le sempiternel refrain de la prétendue méconnaissance du phénomène et vulgarisent les indéniables causes physiques en jeu. Ils partagent aussi des pistes et actions à entreprendre, n’hésitant pas à quitter la sphère scientifique pour l’arène politique. Un rappel supplémentaire en même temps qu’une réponse à tous les décideurs qui feignent encore aujourd’hui de découvrir la situation. Ce dialogue hors du temps, véritable invitation à (re)découvrir la figure et l’oeuvre de Carl Sagan, est suivi d’une réflexion sur le traitement médiatique de la question écologique, signée de la journaliste Léa Dang.
Monsieur Henri ou de Judas à Manuel Valls, histoire du centre-gauche.
[Théâtre] Inspiré des travaux du critique littéraire et historien Henri Guillemin, Monsieur Henri nous invite à dépoussiérer le roman national dans une conférence caustique, instructive et diablement rythmée. Aussi loufoque que haut-en-couleur et fort en gueule, ce conférencier sans égal, « bolchévique, catholique et misogyne » (sic), virevolte et explore 2000 ans d’histoire du centre-gauche. De Jésus (ici représenté sous les traits d’un paléo-syndicaliste) à Robespierre, de Voltaire à Adolphe Thiers, c’est une quinzaine de personnages qui prennent vie pour témoigner et nous rappeler quel fut leur rôle dans l’histoire.
Bâtir sur le sable
[Théâtre] – Charlotte ne veut pas d’enfant. Cela, elle le sait depuis qu’elle est toute petite. Mais les certitudes ne font pas les victoires, et sa vie devient malgré elle une revendication permanente. Sara, sa meilleure amie, se projette dans une brillante carrière de statisticienne. Écrasée par la pression sociale, elle ne sait plus vraiment si ses choix sont les siens ou ceux des autres. Laurent est victime d’une maladie génétique qui l’empêche de faire descendance. Confronté aux limites de son propre ADN, il cherche d’autres manières de transmettre son amour, son savoir et son histoire. Bâtir sur le sable entremêle les récits de vie de ces trois personnages, explorant les causes et conséquences de leurs décisions les plus intimes.
Oui, nous voulons l’Europe, mais debout
Haut-fonctionnaire et homme d’État d’une essence qui, sans nul doute, tend aujourd’hui à disparaître, Philippe Séguin fut une figure du gaullisme social. Pupille de la nation né à Tunis en 1943, ce tribun hors-pair, un temps destiné à l’enseignement, embrasse des études d’histoire avant d’intégrer l’ENA. Au cours d’une carrière longue de quatre décennies, il occupe successivement des positions qui l’ancrent au cœur des institutions et de la vie publique française. Conseiller ministériel, député, maire, ministre puis président de l’Assemblée nationale, il retrouvera en 2004 son corps d’origine en devenant premier président de la Cour des comptes. En mai 1992, le discours?fleuve qu’il prononce dans l’hémicycle constitue assurément l’un de ces moments – devenus trop rares – d’absolue dignité parlementaire?; élève son orateur en chef de file de l’opposition au traité de Maastricht?; et expose avec force, acuité et prophétisme les enjeux d’un chemin dont nous pouvons constater, depuis trente ans, les effets et les conséquences sur notre pacte social.
La seule propagande qui vaille se nomme vérité
Journaliste vedette du réseau CBS, sur lequel il officia de 1935 à 1961, Edward R. Murrow est un pionnier des médias modernes, qui révolutionna le traitement radiophoniques et télévisuel de l’information. Visionnaire admiré pour son intégrité et sa pugnacité, il incarne encore pour beaucoup d’Américains un âge d’or révolu de l’investigation et de l’éthique journalistique. De sa couverture du second conflit mondial à ses enquêtes sur l’exploitation des classes ouvrières afro-américaines au début des années 1960, Murrow fut le visage et la voix de l’information pour les millions d’auditeurs et de téléspectateurs qui suivaient Hear It Now, See It Now, CBS Reports ou Person to Person. Le combat acharné qu’il mena à partir de 1953 contre le sénateur McCarthy et la tentation de l’arbitraire, en pleine Guerre froide, fut porté à l’écran par George Clooney dans le film Good Night, and Good Luck.
Percutant, implacable et prémonitoire, le discours qu’il prononça devant ses pairs un soir d’octobre 1958 sonne comme un testament en même temps qu’un avertissement à l’usage de toute une profession… mais plus encore de nos sociétés démocratiques.
Mon Oncle Benjamin
Vif et prétendument épicurien, ce roman posthume d’un auteur à la carrière météorique offre un cocktail peu banal d’humour et de militantisme irrévérencieux. Une œuvre d’une modernité déconcertante et brillante d’anticonformisme. Georges Brassens l’érigeait au rang de classique, déclarant que « quiconque n’avait pas lu Mon Oncle Benjamin ne pouvait se dire de ses amis ».
De l’Hypocrisie des vertus
Premier manifeste du Parnasse, ce texte bref composé par un Théophile Gautier tout juste âgé de vingt-quatre ans accompagna la publication de Mademoiselle de Maupin, qu’il ornait comme préface. Drôle et irrévérencieux, égratignant et tournant en ridicule les Tartuffe de son temps, ce manifeste propose une vision poétique débarrassée de toute contrainte utilitaire, pour n’en déployer que plus puissamment ses ailes esthétiques.
Les Vacances d’un jeune homme sage
Fraîchement recalé du baccalauréat, George Dolonne est envoyé le temps d’un été chez sa tante, pour se ressourcer loin de Paris. L’occasion pour Henri de Régnier d’esquisser et de donner vie à une galerie de personnages naïfs et plaisants, qui se dévoilent le long d’une ballade nostalgique. S’y trouvent rapportés « quelques-uns des petits événements qui, à quinze ans, nous émeuvent le plus et qui, plus tard, nous font sourire, comme on sourit du passé, avec regret et mélancolie ».
L’écrivain et poète symbolise, Académicien français, nous entraîne le temps d’un été dans une bourgade de province au charme méchamment désuet. Un roman d’apprentissage plein de tendresse et de nostalgie.
Mémoires d’un suicidé
Avec la Malle Y Pense, partez à la rencontre de pépites littéraires trop peu connues et replongez dans des textes tout droit exhumés de temps passés.
Académicien français et grand intime de Gauthier mais surtout de Flaubert, Maxime Du Camp n’en a pas moins subi la loi commune à tant de romanciers : l’oubli. A l’inverse de Flaubert, Du Camp écrit lui, ouvertement, pour les lecteurs de son temps ; c’est à eux, avant tout, qu’il cherche à plaire en esquissant ses fictions. Dans ces Mémoires d’un suicidé, il investit la psyché d’une génération “rongée par des ennuis sans remède, repoussées par d’injustes déclassements, attirée vers l’inconnu par les désirs des imaginations déréglées” et à laquelle appartient Jean-Marc, son protagoniste. Ces Mémoires ne seraient-ils finalement qu’un roman offert par un désoeuvré à d’autres désoeuvrés ? A telle question, on ne saurait répondre. Mais il est certain que le lecteur d’aujourd’hui ne peut qu’être saisi, au fil des pages, par l’extrême et tragique contemporanéité des thématiques et interrogations qui traversent Jean-Marc, et qui conduisent inexorablement ce-dernier vers un destin dont le titre ne fait pas mystère.
C’était Musset
Avec la Malle Y Pense, partez à la rencontre de pépites littéraires trop peu connues et replongez dans des textes tout droit exhumés de temps passés.
Essayiste, traductrice, historienne ou encore collaboratrice régulière de la Revue des Deux-mondes : voilà une poignée des activités exercées par Arvède Barine, grande intellectuelle de la Belle Epoque et presque absolument oubliée aujourd’hui. Avec C’était Musset, essai biographique consacré au poète, Arvède Barine démontre une nouvelle fois toutes les qualités d’une plume aussi singulière qu’aérienne pour sonder l’âme humaine et traduire l’esprit de son temps. Une plongée à la découverte de l’oeuvre, du destin et de l’influence de l’Enfant du siècle sur toutes les générations qui eurent vingt ans entre 1850 et 1870, et réédité pour la première fois depuis plus d’un siècle.